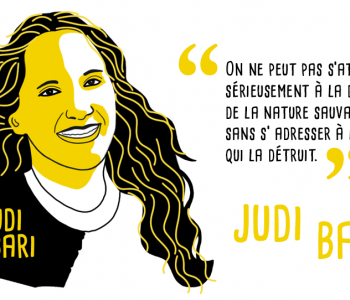Exode et reconstruction : Les femmes ouvrières au cœur…

Des centaines de millions de femmes de la classe ouvrière quittent la campagne pour les villes. Dans un bouleversement sans précédent, imprégné de souffrance humaine, ces femmes sont canalisées vers les industries manufacturières et de services d’une économie mondiale radicalement transformée. Cette délocalisation et cette réorganisation globales de la main-d’œuvre de base du capitalisme sont au cœur même de la mondialisation.
L’exode de ces femmes ouvrières est ancré dans deux processus historiques : la destruction des petites exploitations agricoles et l’apparition d’un nouveau système mondial de production et de distribution – un système avide de main-d’œuvre flexible et aisément exploitable. Ces forces pratiquement inéluctables poussent un grand nombre de femmes hors des exploitations agricoles familiales et les attirent vers de nouveaux secteurs du marché du travail.
Chacun de ces processus, représente un changement majeur dans le capitalisme et la politique capitaliste. Pousser les femmes à quitter la campagne brise les piliers du patriarcat rural traditionnel, l’un des principaux remparts de la domination de classe depuis des siècles. En conséquence, la famille et le genre sont remis en question et remodelés.
Dans le même temps, les nouveaux bassins d’emploi transnationaux remodèlent radicalement l’expérience des femmes en tant que travailleuses, en leur facilitant les contacts avec d’autres femmes et en leur permettant – ou en les obligeant – de devenir bien plus cosmopolites.
En d’autres termes, même si la nouvelle tendance du capitalisme étend sa portée, elle fait simultanément revivre et modernise son pire ennemi – sa classe antagoniste. Les femmes de l’exode,et leurs filles, détermineront l’avenir de la lutte anticapitaliste.
Femmes ouvrières
Distrait par le spectacle du chaos capitaliste sous stéroïdes, il est facile de passer à côté de ce qui est réellement en jeu. Notre nouvelle réalité sociale est toujours ancrée dans l’héritage de l’ancienne : la principale source de profit dans le monde – le fondement du capitalisme – est l’exploitation du travail.
Le travail est la poule aux œufs d’or. C’est la ressource ultime, la denrée indispensable. Le travail esclave et semi-esclave effectué par des milliards de personnes opprimées est la source première de toutes les richesses du monde. C’est l’hôte dont se nourrit le reste de notre économie parasitaire. Le travail imposé enrichit les capitalistes et subventionne le mode de vie de toute une classe moyenne. L’argent des investissements, des infrastructures, du financement de la guerre, des produits de première nécessité, des produits de luxe – tout cela est tiré du travail imposé.
La majeure partie de la force de travail exploitée dans le monde provient des femmes. Les femmes travaillent dans les ateliers clandestins et les grandes usines. Les femmes sèment, entretiennent et récoltent les cultures du monde entier. Les femmes portent, mettent au monde et élèvent des enfants.Les femmes lavent, nettoient, font les courses et cuisinent. Les femmes s’occupent des malades et des personnes âgées. C’est tout cela qui rend la société humaine possible. Le capitalisme est rendu possible par l’exploitation de ce travail.
La prééminence du travail des femmes est généralement évacuée du discours politique, mais c’est un fait incontestable. Plus de la moitié des femmes dans le monde ont un emploi légal. (Dans certains pays d’Asie et d’Amérique latine, ce pourcentage est supérieur à 60 %). De plus, les femmes prédominent dans des millions d’emplois illégaux et semi-légaux, où elles sont souvent durement exploitées. En outre, environ 70 % du travail des femmes, équivalant à des milliards de milliards de dollars par an, n’est pas du tout rémunéré. La plupart des femmes dans le monde consacrent en moyenne 31 à 42 heures par semaine aux seuls travaux ménagers de la famille. Les femmes « font les deux tiers du travail mondial, reçoivent 10 % du revenu mondial et possèdent 1 % des moyens de production ».
Tout au long de l’histoire, des groupes et des classes d’hommes se sont battus pour la précieuse ressource que représente le travail des femmes. De toutes les femmes, mais surtout des femmes ouvrières, qui constituent la source de richesse la plus importante du monde. Des centaines de millions de ces femmes, le cœur et la majorité de la classe ouvrière, n’ont aucune propriété privée ou privilège social. Elles n’ont aucun droit de propriété, de revendication ou de contrôle sur les moyens de production. Cela les distingue de la couche supérieure des travailleurs salariés – aristocrates ouvriers et secteurs privilégiés subventionnés par les profits capitalistes.
Au lieu de cela, elles appartiennent aux couches les plus basses de la classe ouvrière, obligées d’offrir leur travail à l’exploitation capitaliste pour leur simple survie. Cette frange de la classe ouvrière est la principale force de travail du capitalisme et, historiquement, son antagoniste direct.
Nombre de ces femmes ouvrières sont salariées ; beaucoup ne le sont pas. Peu d’entre elles sont payées pour tout leur travail. La plupart sont démunies ou économiquement vulnérables. Elles travaillent dans des conditions extrêmement rudes, faisant non seulement face à la menace de la faim, mais aussi à la dépendance, à l’esclavage et à la violence masculine, soutenu par la tradition, la structure familiale et la loi. Leur expérience du travail et de la vie – et leur position sociale – est souvent très différente de celle des hommes de leur propre famille.
La bataille multiforme pour posséder, contrôler et exploiter cette main-d’œuvre fantastiquement rentable s’exprime à de nombreux niveaux et sous de nombreuses formes : migrations, guerres, génocides, mouvements culturels, rébellions populistes, changements dans la structure familiale, colonialisme, alliances géopolitiques changeantes, montée et chute des gouvernements.
Aujourd’hui, les femmes au cœur de la classe ouvrière mondiale connaissent des changements dramatiques et fondamentaux dans leur vie professionnelle et sociale. Le capitalisme, qui entre dans une nouvelle phase de développement, est en train de transformer la classe ouvrière. C’est là que doit commencer une nouvelle dynamique révolutionnaire.
La montée et la chute de l’anti-impérialisme dans l’après-guerre
Le système capitaliste a été confronté à un défi mortel de la part des mouvements anti-impérialistes dirigés par les socialistes après la Seconde Guerre mondiale. Pendant un certain temps, l’ordre mondial a été secoué ; pendant un certain temps, une puissante alternative anticapitaliste s’est emparée des imaginaires et a mobilisé les efforts de milliards de personnes. Des générations de femmes ouvrières se sont jetées dans cette lutte révolutionnaire, espérant sortir de leur captivité. Pendant plusieurs décennies, cela a semblé être possible.
Mais comme nous le savons, le capitalisme a survécu et a surmonté ce défi. Lorsque ses pouvoirs répressifs sont devenus insuffisants, il a cherché des solutions néocoloniales. Il a exploité toutes les faiblesses de la classe moyenne et des hommes les plus opportunistes. Il s’est réorganisé, s’est adapté et a contourné ses ennemis à tous les niveaux. Il a appris à s’épanouir dans le chaos. Il a trouvé des moyens de transformer l’intégration économique mondiale et la privatisation en nouveaux profits et en nouvelles formes de domination sociale.
Il est important de reconnaître que pour que le capitalisme survive, il a littéralement été forcé de muter sous une nouvelle forme, comme un virus devenu résistant aux antibiotiques. Ce n’est que sous une forte pression que le capitalisme a dépassé ses anciennes limites et s’est déployé sur de nouveau territoires. Pour y parvenir, le capitalisme a dû adopter des mesures radicales, démolir ses propres formes d’organisation sociale devenues obsolètes, mettant en danger l’avenir des nations, les contrats sociaux de longue date, les genres, les races et la vie familiale traditionnelle.
Menacé par un danger révolutionnaire venant de la base, le capitalisme a innové. En revanche, la plupart des opposants anticapitalistes, coincés dans un vieux paradigme, ont échoué, se sont retirés ou ont sombré dans la corruption et la misogynie. Les femmes ouvrières se sont pour la plupart retrouvées à nouveau enfermées sous la domination masculine capitaliste, même là où la lutte pour la libération avait été forte par le passé.
Les vicieuses dictatures masculines coloniales ont été remplacées par des dictatures masculines néocoloniales tout aussi vicieuses. Les contrats sociaux libéraux de la métropole – vestiges inutiles d’une époque antérieure – ont été déchirés et jetés aux oubliettes. De nouvelles classes moyennes et de nouveaux modèles de privilèges sont apparus pour détruire leurs anciennes structures dysfonctionnelles. Les nouvelles technologies ont transformé les marchés, les industries, la technologie, les médias et les méthodes de répression sociale. De nouvelles formes de patriarcat ont remplacé les anciennes. Toute la main d’œuvre existante a été mis à l’écart dans la double lutte du capitalisme pour la survie et le profit.
La vague de luttes anticoloniales d’après-guerre menées par les socialistes a faibli et a reculé. Les nations impérialistes, en particulier les États-Unis, continuent d’attaquer sauvagement les nationalités et les nations les moins puissantes dans le monde entier. Le génocide et l’oppression nationale sont toujours des caractéristiques essentielles du capitalisme mondial. C’est pourquoi les luttes pour la liberté nationale se poursuivent. Et certaines ont un caractère progressiste.
« Mais le néocolonialisme et la réorganisation mondiale du capitalisme ont radicalement remodelé le paysage politique. Des dizaines de nations en Asie, en Afrique et en Amérique latine qui ont brisé l’emprise de l’impérialisme à l’ancienne par des insurrections populaires et par la lutte armée sont maintenant des participants actifs à un nouvel ordre capitaliste mondial, sous des régimes consentants. (Ces nations, qui intègrent la Chine, le Vietnam, l’Iran, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud,le Nicaragua et bien d’autres, constitueraient la majorité de la population mondiale). Dans de nombreux autres endroits, l’impérialisme a réussi à installer des dirigeants « nationalistes » néocoloniaux, ou à conclure des accords avec des « anti-impérialistes » corrompus. Le nationalisme du tiers-monde n’incarne plus systématiquement, comme autrefois, les espoirs progressistes de la classe ouvrière mondiale. En fait, de nombreux anciens révolutionnaires sont devenus des agents du capitalisme mondial.
Lorsque 360 000 mineurs d’or et de charbon ont quitté leur emploi en Afrique du Sud en 1987, pour protester contre les bas salaires et les conditions de travail sordides des mines à l’époque de l’apartheid, un jeune homme charismatique du nom de Cyril Ramaphosa, le chef de file du Syndicat National des Mineurs, a mené la lutte. Mais alors que la police a ouvert le feu sur des travailleurs faisant une grève sauvage dans une mine de platine il y a deux semaines, tuant 34 personnes, M. Ramaphosa, aujourd’hui magnat des affaires, multimillionnaire et haut dirigeant du Congrès National Africain, s’est retrouvé dans une position tout à fait différente : au sein du conseil d’administration de la société contre laquelle les travailleurs faisaient grève, la Lonmin, basée à Londres.
Aujourd’hui, malheureusement, nombre des « anti-impérialistes » les plus militants et les plus victorieux sont devenus des réactionnaires – un assortiment hétéroclite de régimes autoritaires, de populistes de droite, de capitalistes locaux tentant de négocier des parts de marché, de fondamentalistes religieux, de seigneurs de guerre et de gangsters. Les luttes pour la liberté nationale ont tendance à dégénérer en une lutte pour la propriété et le contrôle néocolonial des ressources nationales, y compris le travail et le corps des femmes. Sur ce nouveau terrain, les intérêts des femmes ouvrières sont rarement représentés par les luttes « anti-impérialistes » dominées par les hommes. »
New York Times, 31 août 2012
Il est impossible de revenir à l’époque révolue de l’anti-impérialisme. Pour défier le capitalisme mondial moderne, l’anti-impérialisme progressiste devra vaincre la politique néocolonialiste et renverser son héritage de corruption et d’opportunisme masculin.
Nouveau territoire
La mondialisation est définitivement un travail en cours. Elle est trop massive pour que quiconque puisse la planifier à l’avance, et trop volatile pour que quiconque puisse la gérer efficacement. Les plus grands capitalistes s’efforcent de surfer sur la vague du changement sans se laisser submerger. En fait, la transition vers une production et une distribution intégrées au niveau mondial a déjà été extrêmement chaotique, accompagnée d’une dévastation économique généralisée. Elle génère continuellement des perturbations sociales extrêmes : guerres, émeutes et crises politiques de toutes sortes.
Les contours complets d’un nouveau modèle capitaliste ne sont encore visibles pour personne. Mais il est déjà évident que les énormes changements en cours dans le système capitaliste tournent autour de l’exploitation du travail, en particulier du travail des femmes ouvrières.
La mondialisation a frappé les femmes ouvrières, déjà appauvries, comme un marteau sur une enclume. Pour plusieurs dizaines de millions d’entre elles, cela signifie quitter leur foyer pour toujours ; cela signifie changer de mode de vie sous peine de mort. Comme nous le verrons, la dernière vague de mondialisation a mis en œuvre la destruction longtemps retardée de l’agriculture à petite échelle et, avec elle, les modèles de patriarcat rural qui ont prévalu pendant des siècles. La mondialisation a déclenché une migration d’une ampleur jamais vue auparavant et qui a modifié de façon permanente le travail des femmes et la façon dont il est contrôlé par les hommes. Elle génère des industries entièrement nouvelles à une toute autre échelle. Elle transfère d’énormes quantités de travail domestique des femmes des familles traditionnelles vers d’énormes industries de services internationales. Elle favorise une augmentation de la terreur masculine publique pour compléter et supplanter la terreur masculine privée dans la famille. Elle parraine de nouveaux rangs de femmes néocoloniales – capitalistes, surveillantes et opératrices – qui coopèrent avec les hommes capitalistes dans l’exploitation des femmes ouvrières.
Le déclin et la chute du patriarcat rural traditionnel
Pour comprendre ce qui arrive aux femmes ouvrières, nous devons nous intéresser aux changements sociaux massifs qu’elles traversent. Cela signifie qu’il faut commencer à la campagne. Cela ne semble pas être une idée intuitive. Lorsque nous pensons au capitalisme, nous avons tendance à penser aux usines et aux villes. Mais en réalité, jusqu’à nos jours, des centaines de millions de travailleurs ont été engagés dans l’agriculture, comme ouvriers ruraux ou comme travailleurs non rémunérés sur des parcelles familiales. (Ce n’est qu’en 2007 ou 2008, selon les experts, que la population urbaine a dépassé la population rurale). C’est là que la plupart des femmes ouvrières ont travaillé pendant des siècles.
Jusqu’à la dernière décennie environ, la classe la plus nombreuse du monde était désignée sous le nom de « paysannerie » – un terme controversé qui englobe toute une série de petites exploitations agricoles familiales. Les fermes familiales ont joué un rôle fondamental dans le système capitaliste, même longtemps après l’introduction de l’agriculture à grande échelle. Non seulement l’agriculture familiale a survécu, mais elle a en fait été activement promue et subventionnée par les gouvernements capitalistes modernes comme moyen de renforcer l’économie nationale et de consolider le contrôle social. Au Japon, par exemple, les petites exploitations agricoles ont pris une nouvelle importance économique et politique après la Seconde Guerre mondiale.
En d’autres termes, des centaines d’années après l’essor de la production de masse et l’explosion de la révolution industrielle, la plupart des habitants de la planète pratiquaient encore l’agriculture, essentiellement de subsistance ou de semi-subsistance, sur des parcelles de terre relativement petites. Cette partie de la population rurale a continué à travailler dans des conditions héritées en grande partie de l’époque féodale.
Pourquoi a-t-il fallu si longtemps au capitalisme pour moderniser complètement l’agriculture et en faire une industrie de production de masse, comme il le fait aujourd’hui ? La réponse est révélatrice : même la petite agriculture « paysanne » était fantastiquement rentable pour le capitalisme, et politiquement avantageuse aussi.
Comme nous le savons, les profits de l’agriculture capitaliste basés sur l’esclavage de l’Afrique et de l’Inde sont en fait ce qui a déclenché l’essor industriel de l’Euro-capitalisme. Mais l’esclavage était une dynamite sociale et politique. Des esclaves d’origines et de sexes différents se sont rapidement unis dans la résistance. Ils ont mené une guerre continue contre les propriétaires d’esclaves et ont saboté la production chaque fois qu’ils le pouvaient. Finalement, l’agriculture des esclaves a été brisée par cette résistance. (Il est intéressant de noter qu’une forme de remplacement de l’exploitation rurale des Afro-Américains était basée sur l’agriculture familiale : le métayage).
L’agriculture familiale était remarquablement efficace pour obtenir un rendement maximum de la main-d’œuvre, tant dans les champs qu’à la maison. En particulier, la vie familiale rurale dominée par les hommes extrayait efficacement et impitoyablement le travail non rémunéré des femmes – qui constituaient la majeure partie de la classe ouvrière rurale. La plus grande partie de la valeur de ce travail, qui était généralement sous le contrôle local des membres masculins de la famille, pouvait ainsi être facilement extraite par les grands propriétaires terriens, les transformateurs, les marchands et les négociants, les fournisseurs et, au sommet de la pyramide, les grandes entreprises et les banques. En outre, tous les risques de l’agriculture – mauvaises conditions météorologiques, parasites, catastrophes naturelles, mauvaises conditions du marché – retombent sur les familles d’agriculteurs.
Les femmes piégées dans des cellules familiales séparées pouvaient être intensivement exploitées et faire l’objet d’une surveillance étroite 24 heures sur 24. C’était une forme d’organisation sociale qui rendait difficile l’union des travailleuses rurales entre elles, et qui rendait également difficile la construction de liens solides avec les hommes du prolétariat.
Ainsi, le patriarcat rural basé sur l’agriculture familiale a continué à être un pilier du capitalisme ; coopté du féodalisme, il a été adapté et cimenté dans la fondation de la société capitaliste. La montée des nations capitalistes modernes s’est souvent appuyée sur l’existence de marchés ruraux distincts, de traditions rurales et de mythologies rurales patriarcales basées sur la famille, qui ont servi de composantes essentielles du nationalisme moderne.
Lorsque le capitalisme a renversé le féodalisme, la vie rurale a souvent maintenu une continuité patriarcale. En fait, le capitalisme moderne s’est attaqué sans relâche à tous les vestiges du pouvoir indépendant exercé par les femmes dans les zones rurales. Pour la plupart, les moyens de production étaient encore détenus ou contrôlés par les hommes. Les hommes de la famille jouaient le rôle de contremaîtres et de surveillants envers « leurs » femmes. Dans les champs et au sein du ménage, les hommes « paysans » possédaient et dirigeaient généralement le travail de centaines de millions de femmes. Ils mettaient les femmes au travail et organisaient l’exploitation de leur travail pour leur propre bénéfice et pour celui des capitalistes. Cette domination, renforcée par la violence, faisait partie intégrante de l’économie capitaliste et de l’ordre social capitaliste, tout comme elle l’avait été pour le féodalisme.
Au-delà de sa stabilité et de sa fantastique rentabilité, la famille patriarcale rurale glorifiée a servi aux capitalistes de modèle culturel standard pour l’exploitation du travail domestique et reproductif des femmes dans toutes les strates de la société ; une base pour les rôles de genre capitalistes qui a été élargie et modifiée pour servir le capitalisme urbain. Le patriarcat rural basé sur la famille a été si profondément ancré dans le capitalisme pendant si longtemps qu’il était presque impensable de l’abandonner. Un changement d’une telle ampleur nécessiterait le développement de transports et de marchés de matières premières mondiaux beaucoup plus avancés et une formidable réorganisation du travail. Il nécessiterait une refonte majeure des systèmes politiques partout dans le monde. Il s’agirait d’un changement radical dans le capitalisme.
C’est ce changement radical qui se produit actuellement. Le patriarcat rural traditionnel basé sur l’agriculture familiale est enfin, progressivement, résolument, écrasé par le capital mondial. Il est impossible de trop insister sur les conséquences de ce processus pour les femmes ouvrières et pour le capitalisme. Le réservoir de travail productif le plus rentable du monde – la classe ouvrière de base, principalement composée de femmes – est essentiellement redéployé dans une configuration radicalement nouvelle.
Destruction des petites exploitations agricoles
La chute du patriarcat rural a commencé après la Seconde Guerre Mondiale avec la poussée de l’industrialisation dans le monde colonial. L’impérialisme occidental était avide de main-d’œuvre manufacturière et de biens de consommation bon marché, et de nombreuses classes dirigeantes du Tiers-Monde étaient heureuses de s’y soumettre. Walden Bello décrit ce qui s’est passé en Asie :
Les gouvernements asiatiques ont fait peser le fardeau de l’industrialisation sur la paysannerie pendant la période des politiques dites « développementalistes », où l’industrie avait la priorité. À Taïwan et en Corée du Sud, la réforme agraire a d’abord déclenché la prospérité dans les campagnes dans les années 1950, stimulant l’industrialisation. Mais avec le passage à une industrialisation axée sur l’exportation en 1965, il y a eu une demande de main-d’œuvre industrielle à bas salaire, si bien que les politiques gouvernementales ont délibérément fait baisser les prix des produits agricoles. De cette façon, les paysans ont subventionné l’émergence de nouvelles économies industrialisées…
… [En Chine et à Taiwan,] l’âge d’or de la paysannerie a pris fin, et la cause était identique : l’adoption d’une industrialisation centrée sur les villes et orientée vers l’exportation…
Il est vrai, en effet, que les défenseurs du monde rural Chen Guidi et Wu Chuntao constatent que l’économie industrielle urbaine a été construite « sur les épaules des paysans ».
Durant cette période, le capitalisme occidental, sous le couvert de la soi-disant « Révolution Verte », a vanté les vertus de l’agriculture de produits de base à grande échelle, en utilisant les semences, les engrais et les machines des entreprises. Cela a davantage fragilisé l’agriculture familiale, a affaibli l’autosuffisance de nombreuses nations rurales et a créé une misère généralisée.
Cependant, ce n’est que dans les années 1990 que le déclin de la petite agriculture s’est transformé en un effondrement complet. Bello décrit ce qu’il appelle « le typhon de la libéralisation du commerce » : Le fait d’obliger les paysans à subventionner l’industrialisation a en effet été très dur. Mais au moins, les règles commerciales de l’époque ont contribué à atténuer la douleur en interdisant les importations agricoles qui étaient encore moins chères que les produits locaux. Pratiquement tous les pays asiatiques ayant un secteur agricole contrôlaient étroitement les importations par le biais de quotas et de droits de douane élevés. Ce bouclier protecteur s’est toutefois fortement érodé lorsque les pays ont signé l’Accord sur l’Agriculture (AOA) et ont commencé à adhérer à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à partir de 1995.
L’AOA a forcé l’ouverture des marchés agricoles en interdisant les quotas, qui ont été convertis en droits de douane, et a exigé des gouvernements qu’ils importent un volume minimum de tous les produits de base à un faible tarif. En même temps, sous le prétexte de contrôler les grosses subventions à l’agriculture dans les pays développés, l’AOA a institutionnalisé les différents canaux par lesquels les subventions passaient, comme les subventions à l’exportation et les paiements directs en espèces aux intérêts agricoles dans l’hémisphère nord…
Avec les importantes subventions américaines et européennes qui ont entraîné une distorsion des prix mondiaux à la baisse, l’agriculture des pays en développement est devenue « non compétitive » dans les conditions de la libéralisation des échanges prescrite par l’OMC. Comme le note l’Organisation des Nation Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), « les hausses instantanées des importations qui ont suivi l’adoption de l’AOA dans un certain nombre de pays en développement ont entraîné des « difficultés consécutives » pour les « industries en concurrence avec les importations ». Le rapport poursuit : « Sans une protection adéquate du marché, accompagnée de programmes de développement, beaucoup de produits nationaux seraient évincés, ou fortement affaiblis, ce qui entraînerait une transformation des régimes alimentaires intérieurs et une dépendance accrue vis-à-vis des aliments importés ».
Ce passage historique à la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires s’est, bien entendu, accompagné du déplacement de millions de paysans.Avant même l’entrée en vigueur de l’AOA, la Banque Mondiale prévoyait que les agriculteurs indonésiens seraient perdants sous ce nouveau régime. En effet, depuis 1995, les producteurs de riz et d’autres produits de base ont été marginalisés. Pendant ce temps, les pressions concurrentielles induites par la libéralisation du commerce ont conduit à l’expansion des plantations commerciales aux dépens des petits exploitants.
Aux Philippines, les producteurs de maïs, les éleveurs de poulets, les éleveurs de bétail et les producteurs de légumes ont été conduits à la faillite en très grand nombre. À Mindanao, où le maïs est une culture de base, de nombreux agriculteurs ont été décimés. Comme l’a décrit l’analyste Aileen Kwa, « il n’est pas rare de voir des agriculteurs laisser leur maïs pourrir dans les champs, car le prix du maïs sur le marché intérieur a chuté à des niveaux auxquels ils ne pouvaient pas être compétitifs ». Avec une production stagnante, les surfaces consacrées au maïs dans tout le pays ont fortement diminué, passant de 3 149 300 hectares en 1995 à 2 150 300 hectares en 2000.
En Chine, des dizaines de milliers d’agriculteurs, y compris ceux qui cultivent le soja et le coton, ont été laissés pour compte avec l’entrée de la Chine dans l’OMC. En effet, pour maintenir et améliorer l’accès de ses fabricants aux pays développés, le gouvernement a choisi de sacrifier ses agriculteurs…
Au Sri Lanka, des milliers de petits agriculteurs ont organisé des manifestations de rue pour protester contre l’importation de morceaux de poulet et d’œufs, affirmant qu’ils étaient chassés des affaires. La FAO a abondé dans le même sens, notant que l’augmentation des importations des principaux produits alimentaires comme les piments, les oignons et les pommes de terre rendait la production locale « précaire, comme le montre la baisse significative des zones de production ».
En Inde, la libéralisation des droits de douane, en avance même sur les engagements de l’OMC, s’est traduite par une crise profonde dans les campagnes. L’économiste indienne Utsa Patnaik a décrit cette calamité comme « un effondrement des moyens de subsistance et des revenus ruraux » en raison de la chute brutale des prix des produits agricoles. Parallèlement, la consommation de céréales alimentaires a rapidement diminué, la famille indienne moyenne de quatre personnes consommant 76 kg de moins en 2003 par rapport à 1998 et 88 kg de moins qu’une décennie plus tôt. L’État d’Andra Pradesh, devenu synonyme de détresse agraire en raison de la libéralisation des échanges, a connu une hausse catastrophique du nombre de suicides d’agriculteurs, qui est passé de 233 en 1998 à plus de 2 600 en 2002. Selon une estimation, quelque 100 000 agriculteurs indiens se sont suicidés en raison de l’effondrement des prix dû à l’augmentation des importations.
La destruction de la petite agriculture et de la vie rurale traditionnelle que Bello décrit en Asie est en fait un phénomène mondial. Anuradha Mittal décrit un exemple en Amérique latine : En raison de la suppression des droits de douane sur les produits agricoles, le Mexique, un pays autrefois autosuffisant en céréales de base, importe aujourd’hui 95 % de son soja, 58 % de son riz, 49 % de son blé et 40 % de sa viande. Les producteurs de maïs mexicains ont donc été mis en faillite. Plus de 80 % des Mexicains extrêmement pauvres vivent dans les zones rurales et plus de deux millions sont des producteurs de maïs. Il n’y a aucun moyen pour eux de concurrencer l’agrobusiness américain subventionné. Chaque jour, on estime que 600 paysans sont contraints de quitter leurs terres.
Dans son article de 2005 intitulé « La Crise Agricole : Comment Nous Tuons le Petit Agriculteur », Steven Gorelick décrit la tendance dans la vie rurale :
En Chine, par exemple, la modernisation de l’agriculture a déjà entraîné le déracinement de plus de la moitié de la population rurale au cours des deux dernières décennies. Dans les années à venir, les forces économiques vont arracher tellement de Chinois à leurs villages qu’il faudra construire 600 nouvelles villes pour faire face à l’exode rural, selon le vice-ministre chinois de la construction.
L’économie mondiale a été tout aussi impitoyable avec les agriculteurs des autres régions du Sud. Les bergers d’Afrique de l’Ouest ont été remplacés par des importations de viande bon marché en provenance d’Europe, tandis que les agriculteurs indiens qui cultivent des oléagineux traditionnels comme le sésame, le lin et la moutarde sont poussés à la faillite par le soja importé d’Amérique.
Les producteurs de bœuf mexicains perdent du terrain face aux producteurs américains, dont la part de marché au Mexique a triplé depuis la ratification de l’ALENA. Au Ladakh, une région où 90% de la population vit de l’agriculture, l’orge, aliment de base traditionnel, est remplacé par le blé et le riz du Pendjab acheminés par camion à travers l’Himalaya. Un agriculteur du Ladakh s’est demandé « que va-t-il se passer à l’avenir, maintenant que les choses changent autant ? Aurons-nous encore besoin d’agriculteurs ou pas ?
Actuellement, l’agriculture est en plein essor – pour certains. Alors que les petits agriculteurs sont chassés, l’agriculture industrielle s’installe. Les entreprises sont désireuses d’acquérir des terres arables, dont le prix a considérablement augmenté.
Parfois, des capitalistes impatients se passent de toutes les feintes mensongères du « libre-échange » et expulsent tout simplement les petits agriculteurs. En Afrique, les entreprises occidentales s’associent à des gouvernements corrompus pour s’emparer des petites exploitations agricoles, expulsant de force les agriculteurs familiaux et les remplaçant par des entreprises agroalimentaires :
La demi-douzaine d’étrangers qui sont arrivés dans ce village isolé d’Afrique de l’Ouest ont apporté à ses agriculteurs des nouvelles alarmantes : leurs humbles champs, labourés de génération en génération, étaient désormais contrôlés par le chef de la Libye, le colonel Mouammar el-Kadhafi, et les agriculteurs devaient tous partir.
« Ils nous ont dit que ce serait la dernière saison durant laquelle nous pourrions cultiver nos champs ; après cela, ils raseraient toutes les maisons et prendraient les terres », a déclaré Mama Keita, 73 ans, la cheffe de ce village dissimulé derrière un maquis dense et épineux. « On nous a dit que Kadhafi possédait maintenant ces terres.
« En Afrique et dans les pays en développement, une nouvelle ruée vers les terres émergées engloutit de grandes étendues de terres arables. Malgré leurs traditions ancestrales, des villageois stupéfaits découvrent que les gouvernements africains sont généralement propriétaires de leurs terres et les louent, souvent à des prix avantageux, à des investisseurs privés et à des gouvernements étrangers pour les décennies à venir…
Les effets dévastateurs de l’agriculture industrielle et du « libre-échange » sur les petits agriculteurs ont été mis en parallèle avec la montée rapide de l’agrobusiness multinational, suivant la voie tracée par la « Révolution Verte ». Des sociétés géantes comme Cargill, Monsanto et Archer Daniels Midland contrôlent désormais tout ce qui concerne l’agriculture de haut en bas : la terre, les semences, les engrais, les stocks d’aliments pour animaux, la main-d’œuvre, la transformation des produits agricoles, le transport, le financement, le marketing. De plus, le capitalisme mondial s’empare et privatise avec insolence ce qui était autrefois des biens publics : l’eau, l’air pur, le génome, les océans. (C’est le processus que Vandana Shiva appelle la « nouvelle enclosure des biens communs »). Ils externalisent les coûts et les effets secondaires toxiques de l’agriculture et de la fabrication industrielles sur le public, exigent des subventions fiscales et déversent des déchets toxiques dans les espaces publics et les communautés pauvres.
Les bouleversements dans la production alimentaire ont été particulièrement dévastateurs. À cause de la révolution verte, l’agriculture du Tiers-Monde est devenue une entreprise de denrées de base, la production alimentaire mondiale a atteint des niveaux jamais vus auparavant – et à cause de cela, des millions de personnes sont mortes de faim et de malnutrition. Le paradoxe peut être défini comme suit : plus il y a de nourriture, plus il y a de décès par manque de nourriture.
D’anciennes nations touchées par la famine, comme l’Inde et le Bangladesh, exportent aujourd’hui des denrées alimentaires…Aucune nation opprimée n’est trop pauvre pour participer à ce grand transfert de nourriture vers l’économie néocoloniale. Chaque projet d' »aide » venant de la métropole ne fait qu’accélérer la transformation de l’agriculture, qui passe de la production directe de nourriture à la production de produits dérivés pour le commerce multinational.
Il est évident que les changements introduits par l’agriculture capitaliste ont des effets négatifs considérables sur notre santé, le climat, l’approvisionnement alimentaire et la biodiversité, effets que tout mouvement de lutte contre le capitalisme devra prendre en compte. Dans le même temps, ces changements ont déclenché la plus grande vague de migrations jamais vue, des migrations qui transforment les rapports de classe dans le monde entier et sapent les anciennes formes de contrôle patriarcal. Elles incarnent une révolution dans la manière dont le capitalisme exploite son irremplaçable force de travail, les femmes ouvrières. Le déclin de la petite agriculture, et du patriarcat rural qui l’accompagnait, détermine comment la classe ouvrière se heurte à la mondialisation : comme la fin d’un mode de vie, comme un exode.
La grande migration et sa « féminisation »
Tout au long de son histoire, l’expansion capitaliste s’est accompagnée de déplacements de population de la campagne vers les villes. Ce n’est pas nouveau. Mais l’ampleur et la portée de la migration mondiale actuelle, déclenchée en grande partie par la destruction des petites exploitations agricoles, sont sidérantes. Des centaines de millions de personnes traversent le globe ; un nombre encore plus important d’entre elles migrent dans leur propre pays ou leur propre région.
Au moins 200 à 250 millions de Chinois ont déjà quitté les campagnes pour aller travailler dans les villes. Les chercheurs affirment que les deux tiers de la population rurale totale de la Chine et de l’Indonésie (le quatrième pays le plus peuplé du monde) vont migrer au cours des deux prochaines décennies. Plus de deux millions d’agriculteurs sont contraints de quitter leurs terres chaque année en Inde (quelque 8 000 migrants ruraux arrivent à Delhi chaque semaine). Des bidonvilles géants apparaissent autour des grandes villes du monde, en grande partie peuplés de personnes quittant la campagne. Dans le monde, environ un milliard de personnes vivent sans emploi déclaré dans ces gigantesques bidonvilles tentaculaires. L’Unicef estime à 300 millions le nombre d’enfants vivant dans les rues. Beaucoup d’entre eux sont nés dans des zones agricoles, mais ne seront jamais eux-mêmes agriculteurs. 800 000 femmes asiatiques émigrent chaque année vers le Moyen-Orient, principalement pour travailler comme domestiques. (Au moins 384.822 femmes indonésiennes sont allées dans un seul pays – l’Arabie Saoudite – pour effectuer des travaux ménagers entre 1990 et 1995). En 2006, l’ONU a estimé que 1,2 million de personnes, pour la plupart des femmes et des filles, étaient victimes de la « traite » chaque année. Des millions d’immigrants entrent aux États-Unis et en Europe chaque année. En 2009, on comptait plus de 400 000 épouses d’origine étrangère à Taïwan, un pays de seulement 23 millions d’habitants, et 20 000 nouveaux mariages transnationaux étaient enregistrés chaque année. Cette situation est en grande partie le résultat d’une « industrie de la mariée » mondiale en pleine expansion. (Environ 4 000 à 6 000 femmes par an entrent aux États-Unis par le biais d’agences de « mariage par correspondance »).
Les familles taïwanaises nouvellement riches embauchent des centaines de milliers de travailleuses domestiques philippines, indonésiennes, vietnamiennes, thaïlandaises et mongoles. Il y a des centaines de milliers d' »artistes » étrangers au Japon. Des centaines de milliers de femmes népalaises, pour la plupart mineures, travaillent dans des maison closes en Inde. Des centaines de milliers de femmes immigrées travaillent dans l’industrie du sexe en Europe. En 2004, plus de 1 000 femmes russes travaillaient dans l’industrie du sexe en Corée du Sud. Les femmes migrantes du Myanmar sont la main-d’œuvre principale dans des centaines d’usines en Thaïlande. Dans le même temps, des millions d’hommes seuls venant de l’étranger se rendent en Thaïlande, principalement pour acheter des services sexuels à des femmes venant de la campagne thaïlandaise. (Environ 5 millions d’hommes en 1996.) Entre 1960 et la fin des années 80, selon Fausto Brito, près de 43 millions de personnes ont quitté la campagne brésilienne pour les villes, vidant ainsi des régions agricoles entières. 85% des infirmières philippines travaillent en dehors des Philippines. (Il y a plus de 400 000 infirmières de diverses nationalités nées à l’étranger aux États-Unis).
Les statistiques sont sans fin, les faits sont étourdissants. La classe ouvrière se transforme sous nos yeux. Il faut cependant éviter d’attribuer ce raz-de-marée migratoire à une seule cause. Certaines migrations sont la continuation de migrations établies de longue date. D’autres proviennent des zones urbaines, et non des campagnes. D’autres sont temporaires, du moins dans leur intention initiale. D’autres encore sont « tirées » plutôt que « poussées », c’est-à-dire composées de migrants, y compris des personnes de la classe moyenne, qui sont simplement à la recherche d’une vie meilleure. Et des millions de migrants sont des réfugiés qui fuient la guerre civile, les maladies, les violences domestiques et les catastrophes naturelles.
Néanmoins, la migration massive de la classe ouvrière hors des campagnes a atteint des proportions sans précédent, et se caractérise par un changement fondamental des schémas migratoires. Ses effets sont désormais irréversibles. La vie villageoise traditionnelle et la structure familiale rurale traditionnelle ne reviendront pas. De nombreux migrants retournent dans leur région d’origine, surtout en période de crise économique. Mais en général, ils ne retournent pas à l’agriculture à petite échelle et ils sont réfractaires à l’idée de rejoindre la vie rurale patriarcale traditionnelle. En fait, de nombreux rapatriés repartent dès que l’occasion se présente.
Dans l’œil de cet ouragan migratoire, les familles rurales restantes qui tentent de conserver leurs terres dépendent désormais des virements d’argent de la part de leurs filles et de leurs mères. C’est le cas dans des pays aussi divers que les Philippines, Cuba, le Sri Lanka, la Thaïlande et Haïti. En 1998, selon les Nations Unies, les femmes migrantes ont envoyé environ 70 milliards de dollars dans leur pays d’origine ; ce chiffre a grimpé en flèche, le total des envois d’argent (des hommes et des femmes) atteignant environ 300 milliards de dollars rien qu’en 2005. Dans certains cas, les transferts de revenus sont devenus le plus important flux financier de pays et de régions entières, dépassant souvent 10 %, voire 20 % du PIB national. (Les gouvernements indonésiens et philippins sponsorisent des campagnes publicitaires ayant pour but de montrer les femmes qui travaillent à l’étranger comme étant des « héroïnes » en raison de leur rôle indispensable dans l’économie nationale).
Si ces apports d’argent permettent à certaines familles rurales de tenir le coup temporairement, il transforme radicalement leur mode de vie. Et il est manifestement insuffisant pour rétablir les éléments de base d’une vie rurale traditionnelle. En effet, un pourcentage de plus en plus important des virements d’argent est envoyé aux membres de la famille qui ont eux-mêmes abandonné la campagne pour la ville. De plus, la migration se « féminise » de plus en plus. Comme l’indique l’ONU dans un rapport de 2007 sur la féminisation des migrations internationales :
Bien qu’une féminisation nette des flux se soit produite dans certaines régions, ce qui a réellement changé au cours des dernières décennies est le fait que davantage de femmes migrent de manière indépendante à la recherche d’un emploi, et non plus comme « personnes à charge » voyageant avec leur mari ou les rejoignant à l’étranger. Outre ce changement dans le schéma de migration des femmes, l’autre changement important qui se produit concerne le niveau de sensibilisation des chercheurs et des décideurs politiques en matière de migration quant à l’importance de la migration des femmes et au rôle du genre dans le façonnage des processus migratoires et, surtout, le rôle de plus en plus important des femmes en tant pourvoyeuses de d’argents.Il est néanmoins vrai que ces dernières décennies, le nombre de femmes (et d’hommes) migrants a considérablement augmenté en réponse à l’évolution des marchés du travail dans le monde, notamment à la demande massive de main-d’œuvre féminine bon marché en provenance des pays pauvres pour répondre à la demande croissante de personnel soignant dans les pays riches…. La crise des soins dans le monde développé constitue donc un aboutissement de l’échec catastrophique des politiques de développement dans le monde entier, et plus particulièrement des effets des réformes structurelles néolibérales imposées aux pays pauvres au cours des dernières décennies, qui ont entraîné une augmentation du chômage et du sous-emploi, une réduction des services sociaux, un déplacement de la main-d’œuvre et une augmentation de la pauvreté dans de nombreux pays et régions.
Il est à noter que cette étude faite par les Nations Unies se limite aux migrations internationales, qui sont fortement concentrées sur le travail domestique et l’esclavage sexuel. Pourtant, la migration interne et intra-régionale, comprenant un nombre faramineux de femmes ouvrières qui affluent dans les gigantesques zones industrielles dédiées à l’exportation, est encore plus importante. Toutes ces migrations provoquent des bouleversements en matière de genre.
Par exemple, en Chine, un préjugé de longue date contre les enfants de sexe féminin – véhiculé par l’avortement sélectif et l’infanticide féminin – est en train de disparaître. Ce qui était autrefois considéré comme un « surplus » de jeunes femmes est devenu la main-d’œuvre de choix dans le secteur de la fabrication mondiale, et est désormais considéré comme une ressource précieuse par les familles rurales. Les hommes et les femmes quittent la campagne chinoise. Mais ce sont les femmes qui sont fortement concentrées dans les usines d’exportation où les emplois abondent. Leurs transferts d’argent sont très appréciés. (Les hommes migrants chinois sont concentrés dans la construction, où leur emploi ne tient qu’à un fil dans ce qui est la plus grande bulle immobilière du monde). Les effets sociaux de la migration féminine sont divers. Lorsque les femmes ouvrière émigrent aujourd’hui, elles laissent souvent derrière elles, temporairement ou définitivement, leur conjoint et leurs enfants. Les résultats varient, mais sont généralement dévastateurs pour la vie traditionnelle et les schémas de genre.
Comme le dit une étude de 1990 sur la Chine :
On estime, sur la base de la tendance actuelle du ration fille/garçon à la naissance, que d’ici 2029, il y aura un excédent de 30 millions d’hommes (en âge de procréer) par rapport aux femmes rien qu’en Chine. En outre, avec les possibilités offertes par l’économie de marché, les femmes de la campagne chinoises aspirent de plus en plus à travailler dans les villes et à « se marier ». Comme les modèles de migration des femmes et le marché du mariage correspondent à la hiérarchie spatiale du développement capitaliste, on peut prévoir que des villages entiers dans la plupart des zones périphériques disparaîtront dans un avenir proche lorsque les hommes ne pourront plus y trouver de femmes à marier. Pourtant, d’un autre côté, un rapport du nord-est de l’Inde constate la chose suivante, le vieillissement de la population s’accélère dans les zones rurales, en raison de l’exode des hommes de nos villages, ce qui entraîne une « féminisation de l’agriculture ». Mais en raison de la migration rapide des jeunes femmes, l’agriculture est en train de devenir une « agriculture gérontologique », c’est-à-dire une agriculture dont s’occupent principalement les femmes âgées.
Dans le delta du Mékong, au Vietnam, se trouve une « bombe à célibataire », dû au fait que les jeunes femmes quittent la maison familiale pour chercher un partenaire. Thanh Nien News rapporte que « les jeunes filles de la campagne abandonnent leurs villages à la recherche de l’amour et d’une source de revenus dans les villes, laissant derrière elles des quantités de jeunes travailleurs célibataires ». Des dizaines de milliers de femmes, avec l' »aide » de nombreuses agences de rencontres, partent à l’étranger pour épouser des hommes à Taïwan et en Corée du Sud. Beaucoup d’autres trouvent un emploi dans les usines et les centres de transformation du poisson autour de Ho Chi Minh Ville et dans d’autres centres urbains.
Les femmes sri-lankaises quittent en grand nombre les régions rurales pour aller travailler comme domestiques au Moyen-Orient, au Japon et en Europe. (Plus de 125 000 femmes migrent chaque année vers le Moyen-Orient comme employées de maison).
Michelle Gamburd a étudié les familles sri-lankaises des villages de la région de Naeaegama en 1997. 90% de tous les migrants sont des femmes. Parmi les femmes migrantes, 30 % étaient célibataires et 70 % étaient mariées, séparées ou divorcées. La plupart des femmes divorcées avaient au moins un enfant, et environ la moitié avaient des maris qui étaient sous-employés ou au chômage ».
La plupart des femmes migrantes à Naeaegama laissent leurs enfants à la garde de leur mère ou de leur belle-mère, car leurs maris, même au chômage, refuse de faire des « boulots de femme ». La minorité d’hommes qui défient les rôles existants entre les sexes pour s’occuper de leurs propres enfants sont ridiculisés par les autres. Au lieu de cela, les nombreux hommes laissés par les femmes ayant migré se réfugient dans l’alcool et les clubs de dégustation, gaspillant l’argent envoyé par leurs épouses et terrorisant les villages parleur violence lorsqu’ils sont ivres. Les clubs sont organisés de manière très élaborée. Ils font souvent des dons aux écoles, aux temples et aux politiciens et entretiennent des liens étroits avec les forces de l’ordre.
Pour les hommes dont les revenus sont inférieurs à ceux de leurs épouses ou qui ne profitent pas du salaire de leurs épouses, l’alcool permet de se libérer de leur responsabilité personnelle… La responsabilité retombe alors sur l’alcool pour tous les actes stupides qu’ils commettent et à l’épouse absente pour ce qui est de leur consommation excessive. La prospérité du village reposant principalement sur la migration des femmes vers le Moyen-Orient, la participation à la production et à la distribution de kasippu [alcool de contrebande] fournit aux hommes pauvres de l’alcool, de l’argent, une communauté, une influence politique et un moyen de réaffirmer le pouvoir masculin et le respect perdu face au nouveau rôle économique des femmes.
Soyons clairs : le processus auquel nous assistons ne consiste pas à « transformer les campagnardes en travailleuses ». La plupart de ces femmes sont déjà des travailleuses, même si leurs maris et leurs pères ne le sont peut-être pas. Ces femmes ont travaillé comme ouvrières agricoles, soit dans de grandes fermes capitalistes, soit comme main-d’œuvre non rémunérée dans des fermes familiales détenues et contrôlées par des hommes au service du capitalisme. Elles ont travaillé dans des petites entreprises et ont accompli des heures interminables de travail domestique et de soins qui ont rendu le capitalisme rural possible. Comme nous l’avons vu, ce travail n’est pas seulement un vestige de l’époque féodale. Il a plutôt été transformé il y a longtemps en un pilier du capitalisme mondial et intégré dans les fondations des économies capitalistes modernes.
Dans leurs vies antérieures, ces femmes étaient exploitées et contrôlées principalement au sein de familles rurales dominées par les hommes, une situation qui les isolait et les empêchait de s’exprimer politiquement en tant que classe. Le patriarcat rural a été contraint de renvoyer un grand nombre de ces femmes ouvrières vers un marché du travail transnational en plein essor afin de mieux servir le capitalisme. Bien qu’une grande partie de leur travail soit orientée vers l’industrie manufacturière, une proportion importante et cruciale de leur travail est le même que celui qu’elles effectuaient « chez elles » – travail agricole, travail domestique et soins.
Une classe ouvrière transformée
Les changements économiques et sociaux qui accompagnent la mondialisation ont déclenché une bataille entre les hommes sur la façon dont le nouveau système économique va fonctionner et, surtout, sur la question de savoir qui va contrôler et profiter du travail des femmes. En effet, tous les chamboulements provoqués par la mondialisation ont créé de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants parmi les hommes.
Aujourd’hui, alors qu’un poids lourd du capitalisme en mutation tente de broyer la « paysannerie » mondiale et de pousser les femmes ouvrières dans les bras des gigantesques industries transnationales, l’exploitation du travail des femmes est radicalement reconfigurée. Les femmes sont arrachées aux familles patriarcales rurales et urbaines traditionnelles pour mieux servir le capitalisme. Des groupes d’hommes de toutes les classes se battent désespérément pour résister ou, à défaut, pour obtenir une part du patriarcat post-moderne naissant. Un grand nombre d’hommes se retrouvent complètement exclus de la vie active.
Selon l’Organisation Internationale du Travail, « depuis une trentaine d’années, la tendance dans le monde entier est à l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, alors que le taux d’activité des hommes est en baisse… Plus d’hommes ont été contraints de rester en marge du marché du travail, voire d’en sortir complètement ». L’OIT observe que « les types d’emploi et de condition de vie active traditionnellement associés aux femmes – précarité, faible rémunération, irrégularité, etc. – se sont étendus par rapport au type d’emploi traditionnellement associé aux hommes – régulier, syndiqué, stable, manuel ou artisanal, etc. » Nous pourrions ajouter à cette liste d’emplois masculins en déclin : « surveillants et contremaîtres plutôt que femmes de campagne ».
Ce que les universitaires appellent la « féminisation du travail » ne se produit pas seulement dans le « monde en voie de développement », mais aussi dans les métropoles. En Europe et aux États-Unis, un pourcentage croissant de femmes mariées, de toutes classes et nationalités, gagnent plus d’argent que leurs maris. (Chez les Afro-Américains, par exemple, ce pourcentage est passé de 18 % en 1970à 30 % en 1996).
La famille est toujours une composante importante de la suprématie masculine. Mais elle évolue et devient moins rigide et intouchable. Le thème unificateur du nouvel ordre capitaliste est que le travail des femmes ouvrières est trop précieux pour être laissé entre les mains de « l’homme de la maison ». Le travail des femmes doit maintenant être contrôlé plus directement par les capitalistes et leurs agents, sans toutes les médiations locales encombrantes et inflexibles autrefois réservées aux maris, aux pères et aux frères. Les femmes ouvrières doivent être « libres » de se déplacer de pays en pays, d’industrie en industrie, de ménage en ménage. On a besoin d’elles dans les zones industrielles, on a besoin d’elles dans les grandes fermes industrielles, on a besoin d’elles comme infirmières et comme « divertissement ». Leur travail ménager est de plus en plus délocalisé de leur propre famille et fusionné dans les grandes industries mondiales de services. Les femmes font le ménage et élèvent les enfants de quelqu’un d’autre à l’autre bout du monde. Les femmes pauvres ont toujours travaillé dans ce type de service à domicile, et ont souvent été séparées de leur famille pour le faire. Les familles riches employaient des servantes issues des couches pauvres de la société, et surtout des nations coloniales. Mais la portée, l’internationalisation et la commercialisation de ce marché du travail ont augmenté de manière exponentielle.
Ce qui était autrefois du travail non rémunéré peut maintenant être payé, même peu. Plus précisément, les intermédiaires familiaux du patriarcat rural sont maintenant mis à l’écart. Les capitalistes extraient désormais le profit du travail exploité directement sur le marché, plutôt qu’indirectement, plus haut dans la « chaîne alimentaire ». Le travail des femmes ouvrières dans les champs, les usines et les maisons de particuliers devient massivement socialisé et infiniment mobile. Il est réorganisé et stratifié en fonction des besoins des nouveaux marchés mondiaux. Il est encouragé et organisé par des gouvernements parasites et une armée corrompue d’agences de travail, de marchands d’esclaves et de contrebandiers professionnels. Personne ne demande la permission aux maris ou aux pères pour tout cela.
La transformation de la classe ouvrière, avec les femmes en premier plan, est une promesse de changement révolutionnaire à long terme. Les barrières géographiques et sociales entre les femmes ouvrières s’effondrent progressivement, et ces dernières deviennent de plus en plus cosmopolites. Ce qui ne signifie pas que le nouveau capitalisme mondial est plus clément envers elles. En fait, plus que jamais, le capitalisme est leur ennemi direct, implacable et brutal. Le chaos engendré par cette dernière vague de mondialisation est particulièrement violent pour les femmes. Les femmes sont majoritaires parmi les réfugiés, les démunis et les esclaves. Les anciennes tout comme les nouvelles méthodes d’exploitation du travail et de contrôle social progressent sans être freinées par la coutume ou la réglementation.
Alors que les entreprises ont acquis une nouvelle mobilité transnationale illimitée, les mouvements des femmes ouvrières sont sévèrement limités et réglementés par les contrôles aux frontières et par la ségrégation raciste. À chaque fois, les gouvernements, les agences de migration, les passeurs et les agents intermédiaires escroquent et taxent les femmes migrantes. Des millions de femmes ouvrières laissent leurs enfants derrière elles afin de survivre dans l’économie mondiale. Comme toujours, les conditions de travail de la classe ouvrière sont implacablement dures. Une grande partie du travail des femmes ouvrières est en fait un travail d’esclave ou de semi-esclave, non rémunéré, effectué sous la contrainte.
La violence est endémique là où les femmes ouvrières vivent et travaillent. Là où elles sont concentrées, les capitalistes et les chefs de guerre manipulent et encouragent les hommes dépossédés de leur pouvoir à les terroriser, les pousser hors de la rue et de la vie publique. Et ce n’est pas tout : la destruction du patriarcat rural traditionnel basé sur la famille entraîne un puissant contrecoup réactionnaire masculin.
Des millions d’hommes perdent « leurs » femmes et « leur » emploi, et cela les rend fous. Aujourd’hui, la principale opposition à la mondialisation capitaliste ne vient pas de la gauche anti-impérialiste affaiblie, ou – pas encore – des femmes ouvrières, mais plutôt des hommes de droite. La colère de la dépossession masculine alimente les tendances populistes, fondamentalistes et fascistes réactionnaires dans toutes les régions du monde. Ces mouvements de droite sont généralement dirigés par des hommes des classes moyennes, furieux de perdre les privilèges qu’ils détenaient sous l’ancien ordre capitaliste masculin. Mais des millions d’hommes pauvres et déclassés se joignent à eux, formant une sorte de front uni de la misogynie.
Pour finir, les femmes ouvrières sont confrontées à la montée de nouvelles catégories de femmes néocoloniales. Des femmes qui profitent de l’esclavage sexuel. Des femmes cadres dans les usines. Des femmes criminelles de guerre, des femmes politiques, des femmes agentes, des femmes fonctionnaires, des femmes patronnes. Dans le patriarcat rural traditionnel, il y avait aussi des femmes – souvent des belles-familles – qui jouaient un rôle de soutien dans la domination masculine. Ces femmes gardiennes de l’ancien modèle sont actuellement éliminées avec « leurs » hommes dans le cadre de la nouvelle mondialisation. Pour les remplacer, de nouvelles femmes cadres modernes, professionnelles, militaires et de la classe dirigeante, mieux équipées pour contrôler les femmes ouvrières au sein du nouveau patriarcat mondial, se lèvent.
Pour celles et ceux d’entre nous qui tentent de reconstruire un mouvement anticapitaliste radical, la réorganisation de l’économie mondiale et les changements qui en découlent sur la manière dont les femmes sont exploitées et contrôlées ont une importance fondamentale. Parce qu’à la suite de cette transformation, le noyau de la classe ouvrière – l’ennemi historique du capitalisme – est également en train de se transformer. Cette classe ouvrière reconfigurée, avec les femmes en son cœur, sera la source ultime de nouvelles vagues de résistance et de révolution. Elle engendrera de nouveaux mouvements ouvriers, de nouvelles cultures, de nouveaux partis, de nouvelles insurrections, de nouvelles forces. Nous sommes à un tournant historique majeur, plein de promesses.
À terme, le capitalisme paiera un lourd tribut pour sa longévité. Il est contraint de se débarrasser du patriarcat rural traditionnel, un rempart essentiel du contrôle social depuis des siècles. Il dépossédera et mettra en colère d’innombrables patriarches de petite envergure. Il perturbe les rôles traditionnels des hommes et des femmes. Il envoie des centaines de millions de femmes à travers les pays et les cultures afin qu’elles trouvent des moyens de subsistance. Il remet en question la nature et l’avenir de la domination masculine. Ces changements rendent le capitalisme particulièrement vulnérable à long terme. Mais pendant ce temps, les femmes ouvrières sont prises dans des feux croisés. D’un côté, le pouvoir brutal du capitalisme mondial, qui exploite leur travail par la contrainte et la violence. De l’autre côté, les hommes dépossédés de « leurs » femmes par le nouveau capitalisme, qui recourent de plus en plus à des moyens radicaux et violents pour « défendre » et « réclamer » leur droit patriarcal de naissance, ou du moins s’emparer d’une portion du gâteau dans ce nouvel ordre masculin.
Les femmes ouvrières se battent, mais elles sont en position de faiblesse. Leurs luttes n’ont pas encore acquis la capacité d’autodéfense physique collective, une condition préalable à un réel changement. Pourtant, le vent tourne. Des protestations dans les rues de Juarez aux clandestines révolutionnaires d’Afghanistan en passant par les refuges anti-esclavages du Cambodge, les femmes contestent le fondamentalisme, la violence contre les femmes, l’occupation impérialiste et l’exploitation des entreprises. Dans le contexte de cette grande migration, les femmes ouvrières forment de nouveaux mouvements de travailleurs et de nouvelles communautés, unies par une expérience commune et tirant parti de tous les outils à leur disposition, y compris les téléphones portables et l’internet. L’ère de la révolution masculine est terminée, mais une nouvelle ère de révolte ouvrière commence à se dessiner.
Chaque jour qui passe comporte de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. On peut ouvrir un journal et lire quelque chose comme ça :
Le Bangladesh, autrefois pauvre et insignifiant pour l’économie mondiale, est aujourd’hui une puissance exportatrice, deuxième seulement après la Chine au niveau des exportations mondiales de vêtements, car les usines produisent des vêtements pour des marques comme Tommy Hilfiger, Gap, Calvin Klein et H&M. Les distributeurs mondiaux comme Target et Walmart ont maintenant des bureaux d’approvisionnement à Dhaka, la capitale. Les vêtements sont essentiels à l’économie du Bangladesh, puisqu’ils représentent 80 % des exportations manufacturières et plus de trois millions d’emplois.Mais avec les étiquettes « Made in Bangladesh » désormais courantes dans les magasins américains, la recette de fabrication du Bangladesh repose sur le fait qu’il a les coûts de main-d’œuvre les plus bas du monde, le salaire minimum des travailleurs du textile étant fixé à environ 37 dollars par mois. Au cours des deux dernières années, alors que les travailleurs ont vu leurs maigres revenus érodés par une inflation à deux chiffres, les protestations et les affrontements avec la police sont devenus de plus en plus fréquents.
80% de ces travailleurs du textile, soit quelque 2,4 millions, sont des femmes. Ce que nous pouvons voir dans le journal n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le gros de ce qui jaillit de la colère des femmes ouvrières est invisible pour nous dans la métropole. Lorsque nous entendons des choses sur les femmes actives dans des luttes politiques, y compris des mouvements dirigés par des hommes, il est difficile de prédire où elles se dirigent.
Par exemple, comment pouvons-nous dire ce que l’avenir réserve aux femmes ouvrières du « Printemps Arabe » ? Vont-elles parvenir à se frayer un nouvel espace politique, ou seront-elles reléguées à la périphérie ? Et que dire des centaines de milliers de jeunes filles qui se battent comme des soldats dans les guerres civiles et les conflits entre seigneurs de guerre dans le monde entier ? La plupart d’entre elles sont aujourd’hui des prisonnières virtuels – que seront-elles demain ? Des milliers de femmes ont récemment participé à d’énormes grèves contre Honda et d’autres entreprises de production géantes en Chine. Les femmes vont-elles s’avancer pour prendre la tête de ces luttes ? Des groupes de femmes ont formé des armées de guérilla composées uniquement de femmes au Kurdistan. Comment cela va-t-il évoluer ? Les zapatistes affirment que les femmes sont au cœur de leur soulèvement. Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour l’avenir des femmes ouvrières ? Des femmes gangsters armées apparaissent dans certaines régions sous conflit et certaines zones urbaines désertées du capitalisme mondial. Certaines d’entre elles s’engageront-elles ?
Il est impossible de dire à quoi ressemblera une insurrection mondiale des femmes ouvrières. Tout ce que nous pouvons prédire avec certitude, c’est que des nouveaux types d’organisation et des tactiques inattendues seront générés par l’expérimentation et le sacrifice – comme c’est toujours le cas lorsque la classe ouvrière évolue. L’avenir, comme d’habitude, est en grande partie dissimulé.
Mais ce que nous devrions remarquer, parce que cela se produit sous nos yeux, c’est que la querelle masculine sur la manière d’exploiter et de contrôler le travail des femmes dans le nouvel ordre capitaliste définit et façonne la politique mondiale actuelle. Tant que les femmes ouvrières ne prendront pas les choses en main à l’échelle mondiale, elles resteront prisent au piège des politiques masculines, qui sont des politiques d’une violence mortelle et qui les concernent toutes. Quoi que les radicaux de la métropole décident de faire ou de ne pas faire, le capitalisme a continué son chemin. Son incarnation actuelle exige la marchandisation et l’internationalisation de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des services. Il a besoin d’un accès rapide à des réserves de travailleurs mobiles et flexibles, en particulier les femmes ouvrières.
Pour y parvenir, les capitalistes rebattent leurs cartes et s’efforcent d’étendre leur domination tout en laissant se défaire certaines des plus profondes attaches sociales du capitalisme. En désespoir de cause et sous la contrainte, le capitalisme a jugé nécessaire de socialiser le travail des femmes ouvrières sur une base entièrement nouvelle, pour remodeler la classe ouvrière sous une forme plus avancée et plus cosmopolite. Ce faisant, le rôle central des femmes ouvrières dans l’économie mondiale s’est rapidement révélé. Le nouveau capitalisme est là, apportant avec lui de nouveaux enjeux. Au niveau le plus élémentaire, ce n’est pas une question de pétrole. Ce n’est pas une question de religion. Ce n’est pas une question d’hommes impérialistes contre hommes anti-impérialistes. Il s’agit des femmes et du travail des femmes : des femmes au cœur d’un prolétariat mondial transformé.
Article paru en septembre 2012 : https://kersplebedeb.com/posts/exodus/