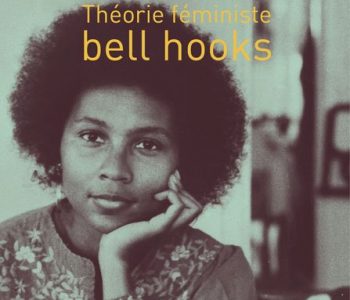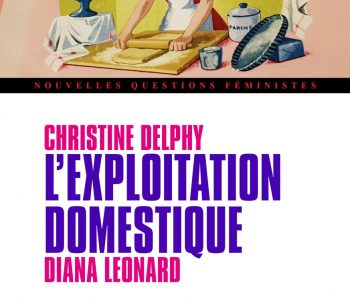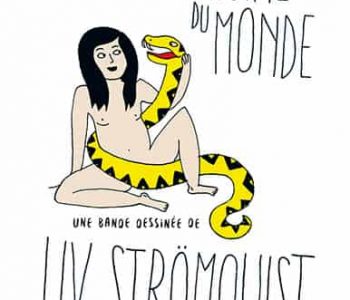Catastrophisme, administration du désastre, soumission durable (Jaime Semprun et…
A l’occasion de l’anniversaire de Mai 68, cet essai prolonge la critique du conformisme qui, selon les auteurs, s’impose universellement au prétexte de sauver la planète, et des nouvelles formes d’embrigadement qui accompagnent la mise en place de la gestion raisonnée du désastre de la société industrielle.
Extrait :
L’extinction finale vers laquelle nous entraîne la perpétuation de la société industrielle est devenue en très peu d’années notre avenir officiel. Qu’elle soit considérée sous l’angle de la pénurie énergétique, du dérèglement climatique, de la démographie, des mouvements de populations, de l’empoisonnement ou de la stérilisation du milieu, de l’artificialisation des êtres vivants, sous tous ceux-là à la fois ou sous d’autres encore, car les rubriques du catastrophisme ne manquent pas, la réalité du désastre en cours, ou du moins des risques et des dangers que comporte le cours des choses, n’est plus seulement admise du bout des lèvres, elle est désormais détaillée en permanence par les propagandes étatiques et médiatiques. […]
La dégradation irréversible de la vie terrestre due au développement industriel a été signalée et décrite depuis plus de cinquante ans. Ceux qui détaillaient le processus, ses effets cumulatifs et les seuils de non-retour prévisibles, comptaient qu’une prise de conscience y mettrait un terme par un changement quelconque. Pour certains ce devaient être des réformes diligemment conduites par les États et leurs experts, pour d’autres il s’agissait surtout d’une transformation de notre mode de vie, dont la nature exacte restait en général assez vague ; enfin il y en avait même pour penser que c’était plus radicalement toute l’organisation sociale existante qui devait être abattue par un changement révolutionnaire. Quels que fussent leurs désaccords sur les moyens à mettre en œuvre, tous partageaient la conviction que la connaissance de l’étendue du désastre et de ses conséquences inéluctables entraînerait pour le moins quelque remise en cause du conformisme social, voire la formation d’une conscience critique radicale. Bref, qu’elle ne resterait pas sans effet.
Contrairement au postulat implicite de toute la « critique des nuisances » (pas seulement celle de l’EdN), selon lequel la détérioration des conditions de vie serait un « facteur de révolte », force a été de constater que la connaissance toujours plus précise de cette détérioration s’intégrait sans heurts à la soumission et participait surtout de l’adaptation à de nouvelles formes de survie en milieu extrême. […]
La dissimulation et le mensonge ont bien sûr été utilisés à maintes reprises, le sont et le seront encore, par l’industrie et les États. Toutes sortes d’opérations doivent être menées dans la plus grande discrétion, et gagnent à n’apparaître en pleine lumière que sous forme de faits accomplis. Mais comme le principal fait accompli est l’existence de la société industrielle elle-même, la soumission à ses impératifs, on peut y introduire sans danger des zones toujours plus étendues de transparence : le citoyen désormais bien rodé à son travail de consommateur est avide d’informations pour établir lui-même son bilan « risques-bénéfices », tandis que de son côté chaque empoisonneur cherche aussi à se disculper en noircissant ses concurrents. Il y aura donc toujours matière à « révélations » et à « scandales », tant qu’il y aura des marchands pour traiter une telle matière première : à côté des marchands de poisons, des marchands de scoops journalistiques, d’indignations citoyennes, d’enquêtes sensationnelles.
Cela étant, l’essentiel du cours du désastre n’a jamais été secret. Tout était là, depuis des décennies, pour comprendre vers quoi nous menait le « développement » : ses magnifiques résultats s’étalaient partout, à la vitesse d’une marée noire ou de l’édification d’une « ville nouvelle » en bordure d’autoroute. […]
Au spectacle qu’offrent les contemporains, on a parfois du mal à se départir du sentiment qu’ils ont fini par aimer leur monde. Ce n’est évidemment pas le cas. Ils s’efforcent seulement de s’y faire, ils s’imposent une foulée de jogging et puisent dans leurs prescriptions d’anxiolytiques, tout en pressentant vaguement que leur corps s’y abîme, que leur esprit s’y égare, que les passions auxquelles on s’y livre tournent court. Cependant, n’ayant plus rien d’autre à aimer que cette existence parasitaire désormais installée sans partage, ils s’accrochent à l’idée que, comme la société qui leur inflige les tourments de la compétition permanente leur fournit les psychotropes pour les endurer, et même s’en récréer (sur le modèle des stakhanovistes de la performance carriériste et hédoniste mis en vedette par le spectacle), elle se montrera capable de perfectionner les contreparties en échange desquelles ils ont accepté de dépendre d’elle en tout.
C’est pourquoi, déjà bien entraînés aux sophismes de la résignation et aux consolations de l’impuissance, ils peuvent rester aussi impavides devant les sinistres prédictions dont on les abreuve. Au moins autant que le contenu de celles-ci, la soudaineté apparente et démonstrativement contrainte de leur officialisation aurait sinon de quoi susciter l’inquiétude du plus confiant des citoyens. Et cette inquiétude aurait tout lieu de tourner à la panique au vu de l’incapacité à imaginer quelque issue de secours praticable dont témoigne le bric-à-brac incongru de pétitions de principe, injonctions morales et sommations à renoncer à quelques commodités techno-marchandes (en échange d’autres plus durables) qui constitue à peu près tout ce qu’on trouve à opposer explicitement à la perspective d’une « extinction finale » ou, pour mieux dire, d’une fin du monde cette fois rationnellement promise. Le fait qu’il n’en soit rien, que le catastrophisme se diffuse sans bruit dans le corps social, est bien dénoncé comme une dénégation par les catastrophistes les plus extrémistes – ceux qui greffent sur la prédiction « scientifique » l’espoir d’un renouveau social, voire d’un « changement de mode de vie ». Mais ils ne voient porter cette dénégation que sur les « menaces » dont ils tiennent la liste à jour, alors qu’elle consiste surtout à se représenter sous forme de menaces, comme ils le font eux-mêmes, ce qui est en fait une réalité déjà là : des pratiques et des rapports sociaux, des systèmes de gestion et d’organisation, des nuisances, des polluants, des poisons, etc., qui ont produit et continuent de produire de la manière la plus tangible des effets délétères sur les êtres vivants, le milieu naturel et la société des hommes. On peut s’en assurer sans recourir à des indices statistiques : il suffit de respirer l’air des villes ou d’observer un public de supporters.
Eu égard au fait que nous avons si manifestement parcouru un bon bout de chemin sur les allées de la fin du monde, on nous concédera l’impossibilité de prendre au mot le catastrophisme et ses menaces ; de juger le désastre de la société mondiale sur ce qu’elle en dit elle-même. La représentation de la catastrophe est fille du pouvoir présent : éloge de ses ressources techniques, de sa scientificité, de la connaissance exhaustive de l’écosystème qui lui permettrait maintenant de le réguler au mieux. Mais comme ce sont précisément les moyens intellectuels et matériels qui ont servi à édifier ce monde menacé de ruine, ce château branlant, qui servent maintenant à établir le diagnostic et à préconiser les remèdes, il ne paraît pas trop aventuré de penser que ceux-ci comme celui-là sont eux-mêmes fort incertains, et voués à leur tour à la faillite.
Toute réflexion sur l’état du monde et sur les possibilités d’y intervenir, si elle commence par admettre que son point de départ est, hic et nunc, un désastre déjà largement accompli, bute sur la nécessité, et la difficulté, de sonder la profondeur de ce désastre là où il a fait ses principaux ravages : dans l’esprit des hommes. Là il n’y a pas d’instrument de mesure qui vaille, pas de badges dosimétriques, pas de statistiques ou d’indices auxquels se référer. C’est sans doute pourquoi si rares sont ceux qui se hasardent sur ce terrain. On grommelle bien ici ou là à propos d’une catastrophe « anthropologique », dont on ne discerne pas trop s’il faudrait la situer dans l’agonie des dernières sociétés « traditionnelles » ou dans le sort fait aux jeunes pauvres modernes, en conservant peut-être l’espoir de préserver les unes et d’intégrer les autres. On pense cependant avoir tout dit lorsqu’on l’a dénoncée comme le produit de la perversité « néo-libérale », qui aurait inventé récemment la fameuse « globalisation des échanges » : on se défend ainsi de reconnaître, après tant d’années et de slogans « anti-impérialistes», que cet aspect du désastre a quelque chose à voir avec une logique d’universalisation depuis longtemps à l’œuvre, et relève de bien plus que d’une simple « occidentalisation du monde », Les innombrables syncrétismes – entre idiotismes locaux et universalité marchande – qui concourent à accélérer si puissamment cette mécanique de l’uniformisation (les décollages indien, chinois, etc., tirant parti de spécificités régionales, c’est-à-dire du matériel humain que les formes antérieures d’oppression leur ont efficacement préparé) montrent qu’il n’est pas de servitude, ancienne ou nouvelle, qui ne puisse se fondre harmonieusement – au sens de l’harmonie spéciale dont la Russie post-bureaucratique donne un magnifique exemple – dans l’asservissement à la société totale ; pour ne pas parler des monstruosités tout à fait inédites que suffit à produire la rencontre entre cette modernité et les régions du monde qu’on ne désespère pas de faire décoller : qu’on songe à la propagation du sida ou aux enfants-soldats en Afrique. Cependant on n’ose en général qu’un regard fuyant sur ce que deviennent là-dedans les possibilités et les désirs des hommes réels. Pour le dire grossièrement, mais dans les termes consacrés : au « Nord » comme au « Sud », la classe moyenne, les « laissés-pour-compte» et les « exclus » pensent et veulent la même chose que leurs « élites » et ceux qu’ils croient « les maîtres du monde ».
Un cliché rebattu, qui prétend résumer de manière frappante les « impasses du développement », et appeler à la contrition, affirme que pour assurer le mode de vie d’un Américain moyen à l’ensemble de la population mondiale, il nous faudrait disposer de six ou sept planètes comme la nôtre. Le désastre est évidemment bien plutôt qu’un tel « mode de vie » – en réalité une vie parasitaire, honteuse et dégradante dont les stigmates si visibles sur ceux qui la mènent se complètent des corrections de la chirurgie esthétique – semble désirable et soit effectivement désiré par l’immense majorité de la population mondiale. (Et c’est pourquoi la vulgarité des nantis peut s’exhiber avec une telle complaisance, sans plus rien conserver de la retenue et de la discrétion bourgeoises : ils suscitent l’envie – il leur faut tout de même des gardes du corps – mais pas la haine et le mépris qui préparaient les révolutions.)
Du reste, certains partisans de la « décroissance », sans doute insuffisamment convaincus de la faisabilité de leurs préconisations, évoquent parfois la nécessité d’une « révolution culturelle » et s’en remettent finalement à rien moins qu’à une « décolonisation de l’imaginaire » ! Le caractère vague et lénifiant de pareils vœux pieux, dont on ne dit rien de ce qui permettrait de les exaucer, en dehors de l’embrigadement étatique et néo-étatique renforcé qu’implique par ailleurs l’essentiel des préconisations décroissantes, paraît surtout destiné à refouler l’intuition de l’âpre conflit que ce serait inévitablement de tenter, et déjà de penser sérieusement, la destruction de la société totale, c’est-à-dire du macrosystème technique à quoi finit par se résumer exactement la société humaine. […]
La croyance à la rationalité technomarchande et à ses bienfaits ne s’est pas effondrée sous les coups de la critique révolutionnaire ; elle a seulement dû en rabattre un peu devant les quelques réalités « écologiques » qu’il a bien fallu admettre. Ce qui veut dire que la plupart des gens continuent d’y adhérer, ainsi qu’au genre de bonheur qu’elle promet, et acceptent seulement, bon gré mal gré, de se discipliner, de se restreindre quelque peu, etc., pour conserver cette survie dont on sait maintenant qu’elle ne pourra être indéfiniment augmentée ; qu’elle sera plutôt rationnée. D’ailleurs les représentations catastrophistes massivement diffusées ne sont pas conçues pour faire renoncer à ce mode de vie si enviable, mais pour faire accepter les restrictions et aménagements qui permettront, espère-t-on, de le perpétuer.
Comment croire autrement à quelque chose comme une « pénurie de pétrole » ? Alors qu’à l’évidence il y a surtout effarante pléthore de moteurs, engins, véhicules de toutes sortes. C’est donc déjà déserter le camp de la vérité, pour le moins, que d’accepter de parler en termes de rationnement nécessaire, de voitures propres, d’énergie renouvelable grâce aux éoliennes industrielles, etc. […]
L’écologie industrielle propose déjà des plans de cités durables ou écovilles « neutres en carbone », avec recyclage des déchets, énergie solaire et toutes les commodités électroniques. C’est d’abord en Chine ou à Abu Dhabi que seront construites ces nouvelles villes coloniales – dans un style architectural bien sûr respectueux des traditions locales –, vitrines de l’impérialisme technologique parvenu à lahaute qualité environnementale. Mais c’est partout que les bureaux d’études des sociétés d’ingénierie se sont mis au travail en prévision des nouvelles normes qu’édictera la gouvernance écologique. Dans son exultation après un « Grenelle de l’environnement » prometteur de parts de marché, un homme d’affaires en arrive ainsi à adopter tout naturellement les accents martiaux d’un directeur de kolkhoze rappelant les objectifs du plan-quinquennal et alignant les slogans du grand bond en avant de l’économie durable : « mobilisation nationale… urgence écologique… sauvegarde de notre planète… futur de nos enfants » ; sans manquer de souligner que « la volonté politique de réhabilitation et de construction de bâtiments, de quartiers ou même de villes écologiques représente pour les industriels de formidables opportunités de croissance» (Gérard Mestrallet, PDG de Suez, « L’environnement, catalyseur d’innovation et de croissance », Le Monde, 21 décembre 2007.) Pour compléter le tableau tout en respectant la parité, citons aussi une directrice du développement durable du groupe Veolia-Environnement, non moins enthousiaste : « La construction et la rénovation « vertes » sont en marche, c’est un marché immense, foisonnant, passionnant et très prometteur, à tel point que le nouvel Eldorado est aujourd’hui celui des clean tech, dans le bâtiment, c’est-à-dire des technologies propres en référence à l’impérieuse nécessité d’alléger l’empreinte carbone de toutes les constructions du monde, conformément à la feuille de route fixée. » (Geneviève Ferone, 2030, le krach écologique, 2008.) […]
Les réfractaires qui voudront mettre en cause les bénéfices, quels qu’ils soient, que la propagande pour la sursocialisation persiste à faire miroiter contre l’évidence même, et qui refuseront l’embrigadement dans l’Union sacrée pour le sauvetage de la planète, peuvent s’attendre à être bientôt traités comme le sont en temps de guerre les déserteurs et les saboteurs. Car l’« état de nécessité » et les pénuries qui vont s’accumuler pousseront d’abord à accepter ou réclamer de nouvelles formes d’asservissement, pour sauver ce qui peut l’être de la survie garantie là où elle l’est encore quelque peu. (On voit ce qu’il en est là où l’on ne peut se targuer de tels acquis historiques.)
Cependant le cours de cette étrange guerre ne manquera pas de créer des occasions de passer à la critique en actes du chantage bureaucratique. Pour le dire un peu différemment : on peut prévoir l’entropie, mais pas l’émergence du nouveau. Le rôle de l’imagination théorique reste de discerner, dans un présent écrasé par la probabilité du pire, les diverses possibilités qui n’en demeurent pas moins ouvertes. Pris comme n’importe qui à l’intérieur d’une réalité aussi mouvante que violemment destructrice, nous nous gardons d’oublier ce fait d’expérience, propre nous semble-t-il à lui résister, que l’action de quelques individus, ou de groupes humains très restreints, peut, avec un peu de chance, de rigueur, de volonté, avoir des conséquences incalculables.