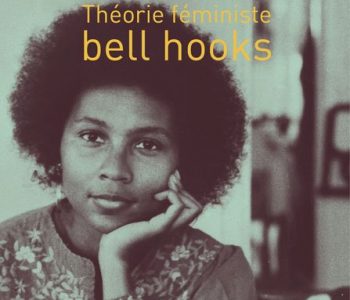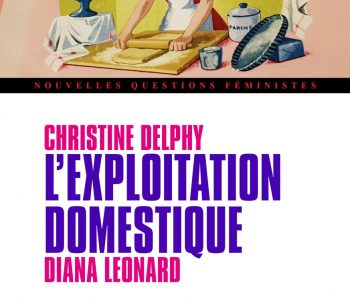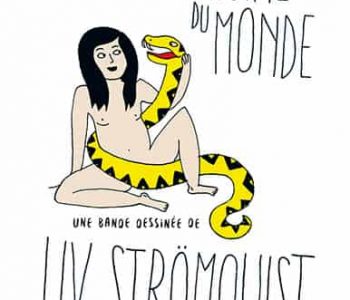Retour aux sources du Pleistocène (Paul Shepard)
Quelles sont les conditions écologiques et les pratiques culturelles les plus adaptées à notre humanité ? Dans quelle mesure l’indifférence, l’ignorance ou la subversion de nos dispositions naturelles sont-elles à l’origine des maux sociaux et environnementaux que connaissent les sociétés contemporaines ? Retour aux sources du Pléistocène, dernier ouvrage de Paul Shepard, s’inscrit dans une perspective qui dépasse l’horizon traditionnel de l’histoire des civilisations.
En mettant en relation le processus d’hominisation avec les types d’écosystèmes qui ont présidé à l’apparition de notre espèce, Shepard interroge différentes possibilités de vivre en accord avec les attributs biologiques et psychologiques que nous avons acquis au Pléistocène. Questionnant les limites et les contradictions dont sont porteuses les conceptions modernes de l’homme, cet ouvrage ouvre de nouvelles voies pour comprendre en quel sens celui-ci doit être réintégré à l’intérieur de la sphère des êtres vivants en prenant acte de leur commune appartenance.
Extrait :
Nous prenons conscience de l’avènement d’un nouvel âge de la Terre, Les conséquences de la Révolution industrielle et de l’exploitation exponentielle des énergies fossiles au XXe siècle signent la fin de l’Holocène. Cet intervalle interglaciaire particulièrement stable fut favorable à l’apparition des civilisations agraires et urbaines. L’époque qui lui succède est marquée par une accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, inégalée depuis 4,5 millions d’années, une extinction de masse des espèces animales sans analogue depuis 65 millions d’années, un remplacement accéléré à grande échelle de la végétation naturelle par des monocultures agricoles, l’acidification des océans qui menace la chaîne alimentaire marine… Forte d’une population de plus de 7 milliards d’individus, ayant presque triplée depuis 1950, désormais majoritairement urbaine et vouée à la consommation globalisée, notre espèce, devenue la principale force géophysique de la planète, célèbre son entrée dans l’Anthropocène. À l’heure de l’énergie nucléaire et de la géoingénierie climatique, l’actualité d’un retour au mode de vie des chasseurs-cueilleurs du Pléistocène semble, pour le moins, paradoxale.
Ce n’est pourtant pas à une utopie nostalgique que Paul Shepard nous convie dans cette oeuvre publiée en 1998, deux ans après sa mort, mais à la recherche d’une alternative viable à l’accélération des destructions environnementales et à l’effondrement annoncé des sociétés industrielles. L’intuition profonde qu’il y poursuit est le fruit d’une réflexion formulée pour la première fois en 1973, lorsque, professeur d’écologie humaine au Pitzer College, il publie The Tender Carnivore and the Sacred Game, suivi en 1978 de Thinking Animais: Animals and the Development of Human Intelligence, puis en 1982 de Nature and Madness. Elle constitue alors l’aboutissement des recherches interdisciplinaires qu’il entreprit au début des années 1950 à l’université de Yale, sur l’esthétique du paysage, et qui le conduisirent, en 1967, dans son premier livre, Man and the landscape, à interroger la « pauvreté en expérience » et l’isolement idéologique de l’homme moderne face à la nature.
Pour Paul Shepard, en effet, l’Histoire au sein de laquelle le monde occidental se définit, dans la postérité de la religion judéo-chrétienne et de la philosophie grecque, est une « déclaration d’indépendance par rapport au temps long de l’évolution humaine ». Disqualifiant comme inférieurs, sauvages ou sous-développés, les peuples qui témoignent encore de cette évolution, l’Histoire a fait de notre appartenance au monde vivant une chose incompréhensible, le point aveugle de notre humanité. Cette déformation mentale fut renforcée par l’idéologie progressiste du XVIIIe siècle, par l’idéologie évolutionniste du sens de l’Histoire issue du XIXe siècle et celle de l’industrialisation et de la croissance économique au XXe siècle. Pour libérer l’avenir, Shepard nous demande donc d’apprendre à penser et à vivre de façon post-historique, c’est-à-dire d’en revenir à la « pré-histoire », et à ses oubliés : les chasseurs-cueilleurs.
Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs n’est pas une simple stratégie de subsistance parmi d’autres : c’est le seul qui fut propre au genre Homo pendant au moins deux millions d’années. Il est le mieux adapté à l’espèce humaine, car c’est le seul ayant fait ses preuves sur le long terme, le seul mode de vie humain connu qui soit vraiment durable. La Révolution néolithique, en rompant avec cette forme de vie, constitue donc une bifurcation autrement plus significative, à l’échelle de l’évolution humaine, que la Révolution industrielle. À partir de la formidable expansion des civilisations des dix mille dernières années, l’Histoire interprète la naissance de l’agriculture comme un progrès dont elle occulte les conséquences négatives anthropologiques (psychologiques, culturelles, sociales) et écologiques. Pour Shepard, au contraire, la sédentarisation, la transformation agricole des paysages et la domestication des animaux et des plantes ont dressé autour des hommes un écran qui les a séparés des organismes sauvages avec lesquels leur sensibilité et leur esprit se sont originellement constitués, leur substituant une « basse-cour » d’êtres amoindris, sélectionnés pour leur placidité, leur docilité et leur aptitude à prospérer en captivité. La Révolution néolithique marque ainsi l’avènement d’un rapport diminué et réducteur à la diversité et à la complexité du vivant, caractérisé par une volonté de domination des habitats naturels, qui tend à détruire ce qu’elle ne peut contrôler. « Dans toute la panoplie des outils développés dans le grand atelier du Paléolithique, il n’y a pas une seule arme fabriquée spécialement pour la guerre… »
Le « primitivisme post-historique » de Paul Shepard fait apparaître à quel point le rapport moderne à la « nature » est une étrangeté, le fruit d’une cosmologie très particulière et très récente quand on la compare aux modes de vie d’autres peuples, et en particulier à celui des chasseurs-cueilleurs. En opposant aux excès de la civilisation agro-industrielle une « contre-révolution paléolithique », Shepard suggère que la connaissance et la reprise éclairée des traits paradigmatiques autour desquels notre espèce s’est façonnée au long du Pléistocène permettront de composer une « mosaïque » culturelle inédite d’où pourront durablement surgir des possibilités de transformation individuelle et collective. Tel est le sens du « retour aux sources » qu’il propose.
Pour comprendre l’émergence de l’esprit humain, Paul Shepard s’intéresse moins à l’histoire des inventions techniques qu’à la façon dont l’observation curieuse d’autres intelligences animales a fondamentalement contribué à l’évolution de nos capacités émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. Il interroge notre fascination et notre émerveillement face à la diversité biologique. Les animaux sauvages, en leur donnant un visage, rendent sensibles des états psychologiques, des qualités mentales et des traits comportementaux dont le discernement a permis aux humains de structurer leur vie intérieure et de se comprendre eux-mêmes. « Les animaux et les plantes sont les corrélats de nos intériorités les plus intimes, tant au sens littéral que métaphorique. » La férocité du lion, la persévérance du loup, la vigilance souveraine du corbeau, l’inquiétude de la gazelle font partie intégrante de nos personnalités. Comme se plaît à le remarquer Shepard, en ornithologue passionné, la contemplation de la pureté du vol des oiseaux a sans doute participé à la formation de nos idées esthétiques et religieuses.
Dans le discours mythique, les espèces animales fonctionnent comme des catégories qui, mises en relation les unes avec les autres, permettent d’ordonner le monde. Paul Shepard fait l’hypothèse que l’accès à la conscience de soi et à la pensée symbolique, et donc l’origine du langage, résultent de la capacité de notre espèce à intérioriser ses interactions écologiques et à leur donner une signification sociale. Il propose ainsi une interprétation originale du grand récit de l’évolution humaine.
Il y a 2,5 millions d’années, dans un contexte de changements climatiques importants, alors que la formation de la calotte glaciaire arctique entraînait une sécheresse en Afrique, provoquant le recul des forêts, les premiers représentants du genre Homo, des primates caractérisés par une socialité intense, s’installèrent dans la savane, riche en aliments variés et peuplée de grands mammifères herbivores et carnivores. Ils entrèrent alors dans le « grand jeu » de la prédation, un jeu de poursuites et de fuites, produit d’une longue compétition, au cours de laquelle les prédateurs et leurs proies avaient co-évolué pendant dès-millions d’années, développant leur force, leur vitesse et leur agilité, ainsi que d’impressionnantes aptitudes cognitives. Les grands carnivores, par exemple, ne se contentaient pas de poursuivre, au gré de leur appétit, les proies qu’ils croisaient. Ils en repéraient les signes, anticipaient leur attaque, prenaient l’avantage en profitant des dispositions du terrain et utilisaient la direction du vent pour dissimuler leur odeur et leur présence, s’approcher en silence et surprendre. Ils chassaient parfois en groupe, tendaient des embuscades, profitaient du comportement grégaire des herbivores pour tirer parti de la panique qu’ils suscitaient, identifiaient et isolaient les individus les plus faibles et vulnérables. Un art élaboré de la prédation se trouvait ainsi intégré dans l’apprentissage des jeunes et transmis entre les générations. D’abord exposés à la redoutable prédation des lions, des léopards et des canidés sauvages, les hominidés adoptèrent longtemps un comportement de charognard, avant de devenir eux-mêmes des prédateurs, chasseurs de grands mammifères, sans pour autant abandonner leur régime alimentaire à base de fruits, de graines, de feuilles et de tubercules. Ils acquirent ainsi un type très particulier d’attention au monde, un esprit omnivore, qui, tel celui du corbeau ou de l’ours, combine la ruse implacable du carnivore à la vigilance prudente de la proie. Shepard souligne cette originaire « étrangeté de l’expérience humaine » qui consiste notamment dans « la capacité à diriger la tension psychique caractéristique des prédateurs au-delà des espèces proies », sur le monde végétal, ou d’autres composantes du paysage. La socialité intense des hominidés les prédisposait par ailleurs à considérer leurs proies comme appartenant à des communautés analogues à la leur. « Tout ce qui faisait leur vie — la nourriture, les ennemis, les intempéries, le danger, les déplacements — était perçu à travers un prisme social. » Ils furent ainsi conduits, comme le montrent les premières mythologies, à interpréter les relations complexes entre les espèces qui peuplaient leurs habitats, en termes de parenté, d’alliance, de descendance et de hiérarchie.
La reconstitution de ce contexte évolutif permet à Shepard de reconnaître, dans la chasse, le mode de vie qui a sculpté le cerveau humain. Celle-ci n’est pas seulement un moyen de se procurer de la nourriture. Dans le prolongement des méditations cynégétiques du philosophe espagnol Ortéga y Gasset, il la décrit comme un « être-au-monde » à l’origine de nos conceptions spirituelles et esthétiques les plus profondes, un « fait social total », dont les surprenantes représentations animales de l’art rupestre constituent les plus anciens témoignages. Le lien généalogique qu’il établit entre la pratique de la chasse et le développement de l’esprit humain, en s’appuyant sur une vaste documentation paléontologique et ethnographique, sur l’éthologie et sur l’anthropologie culturelle, l’amène à conclure que les hommes modernes ont, à leur insu, conservé les dispositions neurophysiologiques et symboliques issues du paléolithique. « Même quand nous concevons une puce électronique dernier cri, nous mettons en pratique des outils cognitifs qui se sont originellement développés pour résoudre des problèmes différents, tels que la capacité à distinguer un prédateur dans les ombres de la nuit (perception-représentation), à suivre les traces d’un animal (induction-abstraction), ou à organiser une chasse en groupe (prévision-déduction). » Le fait de partager avec nos ancêtres d’il y a quarante mille ans une biologie commune sur le plan anatomique et physiologique implique aussi un partage des structures mentales et comportementales. Pendant deux millions d’années, notre corps et notre esprit (taille, anatomie, métabolisme, volume du cerveau, dimorphisme et comportement sexuels, néoténie, etc.) se sont en effet formés dans un monde de chasseurs-cueilleurs. Quelques millénaires d’histoire urbaine ont vu l’invention d’innombrables modèles de sociétés associés â des idéologies et des cosmologies très diverses. Mais le besoin lui-même d’une organisation sociale basée sur une idéologie et une cosmologie trouve sa source dans le mode de vie des chasseurs-cueilleurs du Pléistocène.
Shepard n’idéalise pas un « bon sauvage », il ne propose aucune régression ou retour en arrière. Il nous invite plutôt, aux frontières de la psychologie et de l’écologie profondes, à un travail de réminiscence. Il nous incite à prendre appui sur les formes de vie humaine les plus pérennes et à en tirer des enseignements pour apprendre à aller de l’avant. L’étude des sociétés préhistoriques et traditionnelles permet de ressaisir l’être humain dans son « être-espèce » et d’envisager ses réelles possibilités de métamorphoses. Elle fournit ainsi un cadre de référence indispensable pour prendre du recul par rapport à notre présent dont l’environnement artificialisé, majoritairement urbain, n’a plus grand-chose à voir avec les grands espaces ouverts de la savane, des prairies ou de la steppe.
« Nous “revenons ” avec chaque jour, le long d’une ellipse, à chaque lever et coucher du soleil, chaque rotation du globe. Chaque nouvelle génération ‘‘revient” à des formes propres aux générations antérieures, à partir desquelles l’individu se présente en son ontogenèse singulière… nous ne pouvons pas plus nous détourner des exigences inhérentes et essentielles d’un modèle ancien et répétitif, que l’embryologie humaine ne peut se soustraire à un schéma de développement issu d’un poisson ancestral. » La diversité culturelle ne doit pas faire oublier que toute culture humaine encadre collectivement les passages entre les grandes étapes de la vie : l’attachement à la mère, la séparation de la mère, la formation des premiers liens sociaux dans la petite enfance, la découverte du monde extérieur, le passage de la puberté à l’âge adulte, le mariage, l’enfantement, l’éducation, la vieillesse, la mort. Les cultures des chasseurs-cueilleurs apportent un soin particulier, fait de cérémonies et de rituels, à l’accompagnement de chacune de ces étapes de l’ontogénie. L’individualisme consumériste, le déni de la mort, l’indifférence autiste et la perte d’empathie avec les autres, tant humains que non-humains, constituent, au sein des cultures de masse contemporaines, autant de symptômes alarmants d’infantilisation. Paul Shepard lie intimement la recherche de l’épanouissement spirituel et la réalisation de soi à l’amélioration de la qualité de la vie quotidienne et à la lutte contre les destructions environnementales. Il suggère ainsi que le comportement écologiquement suicidaire des hommes modernes résulte sans doute en partie d’une « psychopathologie épidémique », encore inaperçue, liée à un développement ontogénétique et psychogénétique contrarié par une société qui, victime d’amnésie collective, a inscrit le principe de sa dissociation d’avec la nature dans ses institutions politiques et économiques, et dans son système d’éducation. « Une fois que nous aurons mené notre adaptabilité à l’épuisement de ses limites tant physiques que psychologiques, nous découvrirons que les choix culturels, à la différence de nos corps, ne disposent pas de mécanismes de régulation intégrés. Les contraintes sont mal vues par l’idéologie, faite d’aspirations illimitées, qui règne dans les sociétés d’abondance, au sein desquelles dans la bousculade des individus qui se créent tout seuls, le moi humain est délaissé comme une blessure ouverte. » Dans ces conditions, la reconnaissance du patrimoine commun que nous partageons avec les cultures issues du Pléistocène rend au moins possible un diagnostic des perturbations psychologiques dont Homo sapiens est affecté, et peut éventuellement permettre de conseiller des manières de s’en prémunir.
Cette analyse écopsychologique, parce qu’elle renouvelle notre regard sur nous-mêmes, est porteuse de changement. Elle nous est aujourd’hui d’un grand secours. Alors que les conséquences environnementales désastreuses du fonctionnement normal des sociétés industrielles sont largement avérées, et que la mise en œuvre de politiques efficaces et coordonnées d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre paraît presque utopique, la définition classique de l’homme comme « animal rationnel » est désormais radicalement compromise. La pensée du progrès, issue des Lumières, tend à laisser place à un dangereux pessimisme de l’impuissance et de la démission. En utilisant la préhistoire pour nous guider hors de ce présent sans avenir, Paul Shepard nous procure, au contraire, une belle leçon de confiance et d’espérance.
Ce sont, en effet, les chasseurs-cueilleurs de la fin du Pléistocène qui ont le plus à nous apprendre des capacités humaines d’adaptation aux changements abrupts du climat. Entre la fin du dernier maximum glaciaire, il y a vingt mille ans, et l’orée de l’Holocène, confrontés à des fluctuations climatiques extrêmes, ces peuples, dont les cultures prospéraient dans des conditions glaciaires, se sont maintenus face à l’augmentation importante de la température, l’élévation considérable du niveau des océans, la transformation radicale des écosystèmes dont ils dépendaient et l’extinction subite d’un nombre important d’espèces animales, dont certaines contribuaient, de façon significative, à leur subsistance. Cette transition s’est accompagnée de créations artistiques impressionnantes et de la diffusion de nombreuses inventions techniques, dont les premières formes d’agriculture. En entrant en dialogue avec les chasseurs-cueilleurs, nous adoptons ainsi un autre point de vue sur la fin de l’Holocène. L’avènement de l’anthropocène nous ramène, ironiquement, tels des enfants prodigues, dans la spirale de ce Pléistocène, si climatiquement mouvementé, que nous avions cru définitivement pouvoir laisser derrière nous.
Dans un monde clos, dont la température globale moyenne est appelée à s’accroître de quatre degrés Celsius en moins d’un siècle, il ne sera plus longtemps possible de s’abriter derrière l’abondance des richesses, de maintenir l’illusion que la nature pourrait se plier à des conventions économiques, ou de s’évader dans le rêve technologique d’une domination et d’un contrôle sans limite de la biosphère. Que nous n’ayons pas à revenir au Pléistocène, parce que nous ne l’avons jamais quitté, constitue donc en soi une bonne nouvelle. Le succès adaptatif des chasseurs-cueilleurs est une source d’espoir. L’avenir de notre espèce dépendra aussi de son aptitude au ressouvenir.